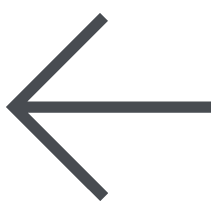Paris #2 Beaubourg, derrière l’image disruptive le retour de l’espace public
Quand on parle de Beaubourg, on discute souvent de son image. Certains dénoncent une « usine », une « cathédrale de plomberie ». Richard Rogers, en laissant les réseaux et la structure apparente pour créer des espaces intérieurs les plus flexibles possibles, fut sans doute le « punk » du binôme avec cette façade qui évoque les dessins futuristes d’Archigram et qui répond, de fait, à l’ambition de désacraliser le musée. Mais la vraie rupture fut ailleurs : dans le vide. Seule cette équipe proposa de laisser libre la moitié de la parcelle ! Renzo Piano défendit ici l’idée d’un espace civique, « public » au sens d’un lieu ouvert et accessible à tous (Roncayolo 2002), résolument populaire ; une ambition comparable à celle des édiles de Sienne qui dégagèrent la piazza del Campo au XIIIe siècle pour marquer le passage à une gestion publique de la cité (Boucheron 2013). À l’emplacement de l’îlot insalubre n°1, détruit en 1934, où le Corbusier imaginait les tours de son « plan voisin », on trouve aujourd’hui l’une des places les plus vivantes de Paris ou le bâti dialogue avec son espace extérieur. Comme à Sienne, la pente douce favorise l’appropriation avec, ici, une façade pensée comme un spectacle permanent. Alors, bâtiment high tech ou retour à une vision traditionnelle de l’espace urbain ? La Piazza Beaubourg s’ouvre en 1977, année où certains situent l’émergence du terme « espaces publics » (Billiard 1988).